La cheminée du Midi
Vanessa Boucher, Fiona Genatzy, Felix-Antoine Meilleur Roy, Capucine Rombi
CUMA
Apparue au début du XXe siècle et déclinée en de nombreux brevets et expérimentations, la cheminée solaire propose d’exploiter la puissance mécanique des mouvements ascendants de l’air une fois réchauffée par le soleil. Souhaitant rivaliser avec les méthodes de production d’énergie conventionnelle, un problème de taille lié à son collecteur semble avoir freiné ces expérimentations.
Cependant, la cheminée solaire est un réel dispositif bioclimatique low-tech composé d’éléments simples. Fonctionnant selon sa propre logique de distribution de l’air et des températures et une fois couplée à l’architecture et à son environnement, elle devient un système esquissant un véritable intérêt technico-spatial.
Cet exercice propose d’explorer les limites d’un mariage entre une cheminée solaire et l’architecture d’une tour-objet en testant l’impact que pourrait avoir son déploiement en zone urbaine. Se laisser prendre au jeu demande d’ores et déjà de penser la relation indissociable entre l’horizontalité d’un collecteur et la verticalité d’un bâtiment-cheminée où l’enjeu principal est d’habiter la technique.

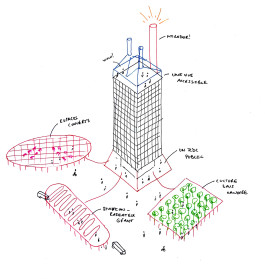
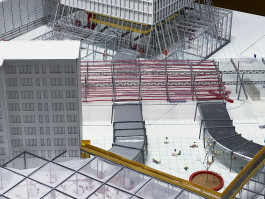







Vue de la tour et de la cheminée du Midi
Schéma montrant les potentialités d'un système technique extériorisé
Vue aérienne sur les collecteurs dans leur contexte d’implantation
Vue intérieure des étages montrant la structure révélée et la technique habitée
Vue du toit-extracteur et de la cheminée pulsant l’air chaud des collecteurs
Vue des collecteurs de type « canopées habitées »
Vue sous les collecteurs-tubes
Vue sous la station servant de radiateur géant
Vue sous l'infrastructure d'accès
Vue intérieure de l'atrium montrant l’espace rendu public et l’accès à la tour
La cheminée du Midi
Vanessa Boucher, Fiona Genatzy, Felix-Antoine Meilleur Roy, Capucine Rombi
CUMA

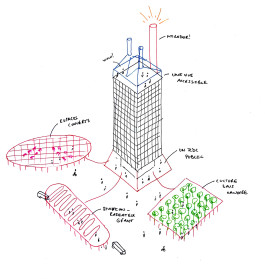
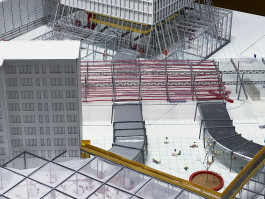







Vue de la tour et de la cheminée du Midi
Schéma montrant les potentialités d'un système technique extériorisé
Vue aérienne sur les collecteurs dans leur contexte d’implantation
Vue intérieure des étages montrant la structure révélée et la technique habitée
Vue du toit-extracteur et de la cheminée pulsant l’air chaud des collecteurs
Vue des collecteurs de type « canopées habitées »
Vue sous les collecteurs-tubes
Vue sous la station servant de radiateur géant
Vue sous l'infrastructure d'accès
Vue intérieure de l'atrium montrant l’espace rendu public et l’accès à la tour
Apparue au début du XXe siècle et déclinée en de nombreux brevets et expérimentations, la cheminée solaire propose d’exploiter la puissance mécanique des mouvements ascendants de l’air une fois réchauffée par le soleil. Souhaitant rivaliser avec les méthodes de production d’énergie conventionnelle, un problème de taille lié à son collecteur semble avoir freiné ces expérimentations.
Cependant, la cheminée solaire est un réel dispositif bioclimatique low-tech composé d’éléments simples. Fonctionnant selon sa propre logique de distribution de l’air et des températures et une fois couplée à l’architecture et à son environnement, elle devient un système esquissant un véritable intérêt technico-spatial.
Cet exercice propose d’explorer les limites d’un mariage entre une cheminée solaire et l’architecture d’une tour-objet en testant l’impact que pourrait avoir son déploiement en zone urbaine. Se laisser prendre au jeu demande d’ores et déjà de penser la relation indissociable entre l’horizontalité d’un collecteur et la verticalité d’un bâtiment-cheminée où l’enjeu principal est d’habiter la technique.